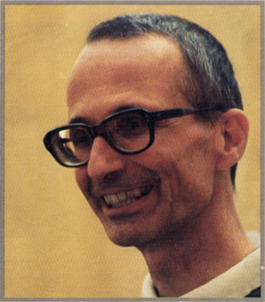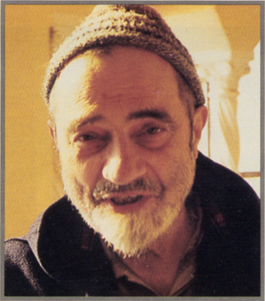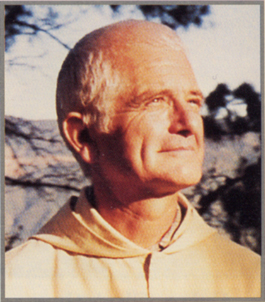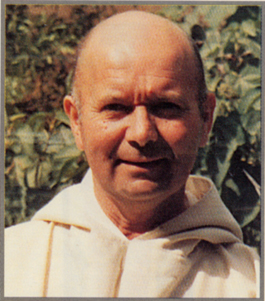Le dernier moine de Tibhirine témoigne
INTERVIEW - Rescapé de la tuerie de 1996, il n'avait jamais parlé depuis la mort des moines de Tibhirine. Nous avons retrouvé frère Jean-Pierre dans un monastère au Maroc, où il a accepté de se confier en exclusivité pour Le Figaro Magazine. Il parle de ses frères disparus, des événements tragiques qu'ils ont vécus, du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Mais aussi de sa foi et de son espérance. Un entretien lumineux.
LE FIGARO MAGAZINE - Avez-vous apprécié le film « Des hommes et des dieux »?
Frère Jean-Pierre. - Il m'a très profondément touché. J'ai été ému de revoir les choses que nous avons vécues ensemble. Mais j'ai surtout ressenti une sorte de plénitude, aucune tristesse. J'ai trouvé le film très beau parce que son message est tellement vrai, même si la réalisation n'est pas toujours exacte par rapport à ce qui s'est passé. Mais cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est le message. Et ce film est une icône. Une icône dit beaucoup plus que ce que l'on voit... C'est un peu comme un chant grégorien. Quand il est bien composé, l'auteur y a mis un message, et celui qui le chante trouve plus encore, parce que l'Esprit travaille en lui. En ce sens, ce film est une icône. C'est une vraie réussite, un chef-d'œuvre.
Vous n'avez aucune critique à formuler ?
J'ai entendu certains critiquer le rôle du prieur, Christian de Chergé. Certains le trouvent un peu effacé, mais je le trouve très bien. D'autres le trouvent austère, car on ne le voit jamais sourire. Mais il est tout à fait dans le personnage qui convient à la situation grave que nous avons traversée. J'admire, dans ce rôle, sa façon d'être à l'écoute des frères, en particulier dans les moments difficiles. Il ne veut pas imposer. Il est à l'écoute. On le sent plein de respect pour les frères. On voit bien le pasteur et son souci de s'ouvrir à Dieu, pour se laisser travailler par Dieu et avoir la réaction qu'il faut devant les frères. Dans tout le film, on voit cette ouverture à Dieu, on l'interroge, on se laisse influencer par Lui. C'est monastique!
Y a-t-il un manque par rapport à l'histoire réelle ?
Je n'ai pas ressenti cela.
Mais comment, en tant que moine, vivez-vous le succès du film ?
Nous sommes comblés et émerveillés de voir un tel succès, mais nous n'y sommes pour rien! Le fait d'être connu me gêne un peu... Un moine est fait pour être caché.
Pourquoi étiez-vous opposés au principe du tournage du film ?
Nous n'avons pas voulu accepter le film et son tournage au Maroc, en raison du danger d'être soupçonnés de prosélytisme. Certains, à ce moment-là, ne recevaient plus leur carte de séjour depuis très longtemps. Nous devions être très prudents mais nous étions abandonnés à la volonté du Seigneur. Nous n'avons donc pas été consultés. L'équipe savait notre opposition et les raisons de notre prudence. Ils ont été très respectueux.
Quand êtes-vous arrivés à Tibhirine ?
Je n'oublierai jamais ce 19 septembre 1964. Quand nous sommes arrivés en 2 CV près du monastère, je verrai toujours cet enfant, assis sur un âne, qui vint à notre rencontre pour nous accueillir. J'étais très heureux. De ma petite cellule, je voyais la clôture, le jardin et le village au loin. Je me suis alors dit: voilà le paysage que je verrai jusqu'à la fin de ma vie. Car dans mon cœur, c'était pour la vie. Sans retour. J'y suis resté trente-deux ans, de 1964 à l'enlèvement en 1996.
Comment était la vie là-bas ?
Les débuts ont été difficiles. La communauté manquait de stabilité et ce fut une période très dure à vivre. Par ailleurs, la nouvelle Algérie se mettait en place. Les relations avec les gens aux alentours n'étaient pas évidentes. Il y avait des réflexes de rejet des Français. On ressentait ce fossé à l'occasion des fêtes, chrétiennes ou musulmanes. On n'avait rien à voir les uns avec les autres. Nous avons donc lutté contre cela et essayé de nous apprivoiser mutuellement. Pour cela, le dispensaire, tenu par le frère Luc, fut très important. Il recevait jusqu'à 80 personnes par jour! Puis, Christian de Chergé a été élu prieur, en 1984. Nous avions besoin de quelqu'un comme lui qui parlait l'arabe et connaissait bien la culture musulmane. À partir de là, nous sommes devenus une vraie communauté, plus stable. Ceux qui s'engageaient le faisaient vraiment. Nous étions quasi indépendants. Ce qui fut un avantage, car cela nous a permis de prendre beaucoup d'initiatives dans la relation islamo-chrétienne.
Quel rôle Christian de Chergé a-t-il joué ?
Il y a eu, avec lui, une évolution vers l'islamologie. Il a personnellement beaucoup étudié le Coran. Le matin, il faisait sa lectio divina, avec une Bible en arabe. Il faisait parfois la méditation avec le Coran. Il cherchait à nous faire évoluer. Nous avions des relations avec l'islam, mais pas à un niveau intellectuel. Lui connaissait très bien le milieu musulman et la spiritualité soufie. Certains moines estimaient que la communauté devait rester équilibrée et que tout ne devait pas être orienté par l'islam. Ce qui provoqua des frictions. Ces tensions finirent par être dépassées grâce à la création d'un groupe d'échange et de partage avec des musulmans soufis, que nous avions appelé le ribât. Nous avions compris que la discussion sur les dogmes divisait, car elle était impossible. On parlait donc du chemin vers Dieu. On priait en silence, chacun selon sa prière à lui. Ces rencontres bisannuelles ont été interrompues en 1993, quand cela a commencé à devenir dangereux. Mais cette connaissance mutuelle a fait de nous de vrais frères, en profondeur.
En quoi le père Christian de Chergé vous a-t-il marqué ?
Ce qui m'a frappé chez lui, c'est sa passion intérieure pour la découverte de l'âme musulmane et pour vivre cette communion avec eux et avec Dieu, tout en restant vraiment moine et chrétien.
De qui étiez-vous le plus proche ?
De frère Luc! On était très proches tous les deux. Il n'était pas prêtre, il était frère. On pouvait se confier à lui. Il était plein de sagesse. Dans une petite communauté où il n'y a pas beaucoup de prêtres, il n'est pas facile de trouver un directeur spirituel. Si on avait un problème ou une difficulté de relation avec un frère, on allait d'abord voir frère Luc, sachant très bien comment il allait répondre. C'était un modèle... Au chapitre, même pendant la période de tension et de peur, il avait toujours le mot pour faire rire. Il était précieux pour la vie commune. Même si, comme médecin, il avait un régime spécial, car il était dans son dispensaire toute la journée et qu'il faisait, en plus, la cuisine! Il commençait ses journées à 1 heure du matin pour être prêt à 7 heures au dispensaire. Il avait beaucoup d'asthme et n'arrivait pas à dormir. Il dormait assis! J'étais très proche aussi de frère Amédée, l'autre rescapé, qui est mort ici, à Midelt.
Priez-vous avec vos frères disparus ?
J'essaie d'avoir un temps, tous les matins. On ne les oublie pas. Ils restent présents. Tous. On essaie de progresser. Le film, de ce point de vue, nous stimule dans notre vocation.
Vos frères vous parlent dans la prière ?
Non, pas encore... J'ai la certitude qu'ils sont près du Seigneur. Je l'ai eue dès le début en raison de leur martyre. Cela donne de la joie, pas de la tristesse. C'est ce que j'éprouve en voyant le film: de la joie, pas de la nostalgie! (rire). En espérant que le Seigneur nous envoie d'autres moines qui voudront vivre cela.
Ne ressentez-vous jamais de nostalgie pour la vie à Tibhirine ?
Un peu, oui... Nous avons vécu de très belles choses ensemble. Et puis, cette vie en commun pour représenter le Seigneur et l'Église. C'est une très belle vocation. Elle peut aller loin. Le Christ est plus grand que l'Église. Les soufis utilisaient une image pour parler de notre relation avec les musulmans. C'est une échelle à double pente. Elle est posée par terre et le sommet touche le ciel. Nous montons d'un côté, eux montent de l'autre côté, selon leur méthode. Plus on est proches de Dieu, plus on est proches les uns et des autres. Et réciproquement, plus on est proches les uns des autres, plus on est proches de Dieu. Toute la théologie est là-dedans!
Et pourtant, c'est la mort qui était au rendez-vous...
Ce que nous avons vécu là, ensemble et dès le début, était une action de grâce. On s'était préparés ensemble. Par fidélité à notre vocation, on avait choisi de rester en sachant très bien ce qui pouvait arriver. Le Seigneur nous envoie, on ne va pas démissionner même si, autour de nous, les violents cherchent à nous faire partir, et même les officiels. Mais nous avons Notre Maître et nous étions engagés par rapport à Lui. En second lieu est venue la volonté d'être fidèles aux gens de notre environnement pour ne pas les abandonner. Ils étaient aussi menacés que nous. Ils étaient pris entre deux feux, entre l'armée et les terroristes, les maquisards. La décision de ne pas se séparer avait été prise en 1993. Et même si nous avions été dispersés par la force, on devait se retrouver à Fès, au Maroc, pour repartir s'établir dans un autre pays musulman.
Comment vivez-vous ce qui s'est passé: comme un échec ou comme un accomplissement ?
Après l'enlèvement, le père Amédée et moi avons été obligés de descendre à Alger avec la police. On priait pour nos frères. Pour que Dieu leur donne la force et la grâce d'aller jusqu'au bout. On attendait une intervention de la France ou une intervention ecclésiastique qui obtienne leur libération. On a appris leur mort le 21 mai 1996. Nous étions en train de prier les vêpres. Soudain, un jeune frère est arrivé à la chapelle et s'est jeté devant tout le monde à plat ventre, criant son désespoir: «Les frères ont été tués!» Le soir, alors que nous étions côte-à-côte à faire la vaisselle, je lui ai dit: «Il faut vivre cela comme quelque chose de très beau, de très grand. Il faut en être digne. Et la messe que nous dirons pour eux ne sera pas en noir. Elle sera en rouge.» Nous les avons tout de suite vus, en effet, comme des martyrs. Le martyre était l'accomplissement de tout ce que nous avions préparé depuis longtemps, dans notre vie. Ces années que nous avions vécues ensemble dans le danger. Nous étions prêts, tous. Mais cela n'a pas exclu la peur.
Quand la peur a-t-elle commencé ?
À partir de 1993, lors de la visite du GIA, le soir de Noël. La communauté s'est alors beaucoup développée en union et en profondeur. Le danger était désormais partout, de tous les instants, nuit et jour. Cela nous a beaucoup secoués. On est vraiment passés par le creux à ce moment-là.
Que s'est-il passé exactement ?
Noël 1993, le soir, ils ont fait le mur. On était dans la sacristie avec Célestin, qui préparait les fiches de chants pour la messe de Noël. Des hommes armés jusqu'aux dents nous ont encerclés. Les Croates venaient d'être tués, on pensait y passer aussi. Ils nous ont rassurés. Parce que nous étions des religieux, ils ne nous feraient rien. Mais ils ont alors commencé à taper sur le gouvernement. Puis le chef a dit: «Je veux voir le pape du coin.» On est allés chercher Christian, qui a tout de suite dit: «Non, on n'entre pas ici avec des armes. Si vous voulez venir ici, laissez vos armes à l'extérieur. Personne n'est jamais entré ici avec des armes. Ici, c'est une maison de paix!» Ils ont finalement discuté et ont demandé trois choses: que le docteur puisse venir soigner les blessés dans la montagne, des médicaments, de l'argent. Avec tact, Christian a répondu non aux trois demandes. Sauf pour les blessés, qui pouvaient venir, comme tout le monde, au dispensaire. Puis il a dit en arabe que nous préparions «la fête de la naissance du prince de la paix». Ils ne le savaient pas et se sont excusés, mais ils ont dit: «On reviendra.» En donnant un mot de passe: ils demanderaient «monsieur Christian». Ce soir-là, la messe de minuit a eu un goût particulier. Le lendemain, au chapitre, nous avons commencé les discussions sur l'avenir.
Qu'avez-vous alors décidé ?
Que s'ils demandaient de l'argent, on leur en donnerait un peu pour éviter la violence, mais nous pensions toutefois partir, car nous ne voulions pas collaborer avec eux. Puis l'évêque d'Alger est venu nous dire que si l'on décidait de quitter, il ne fallait pas quitter tous ensemble, pour ne pas affoler l'Église d'Algérie. On a décidé que deux d'entre nous partiraient. Célestin, qui avait été traumatisé par ce Noël et qui devait subir six pontages cardiaques, et frère Paul, qui avait besoin de repos.
Y avait-il unanimité entre vous ?
Il y a eu un autre chapitre après ce Noël. Les uns pensaient qu'il fallait rester, les autres qu'il valait mieux partir. D'autant qu'à ce moment-là, par sécurité, nous avons été obligés de fermer le monastère dès la fin de l'après-midi et jusqu'au matin. Nous avons aussi dit aux retraitants de ne plus venir. Nous étions isolés. Cela a changé l'économie du monastère et il fallait trouver d'autres moyens pour vivre.
Il y a donc eu des divergences ?
Ça a évolué. Le père Armand Veilleux, venu prêcher une des dernières retraites, nous avait dit que nous étions arrivés «au sommet» de notre vie commune. Nous étions en effet parvenus à l'unanimité à la décision de rester. Les relations fraternelles s'étaient encore soudées. En chapitre, nous ne pouvions prendre à la légère des décisions aussi graves. Par rapport au GIA, par rapport à un départ, sur notre conduite si nous étions enlevés ou dispersés... Nous étions alors tous décidés à rester, mais la peur de ce qui allait arriver était présente, plus ou moins, chez les uns et les autres. Mais il fallait continuer à vivre. Il y avait des attentats à droite et à gauche. Des proches du monastère avaient été arrêtés ou menacés. Voilà le climat dans lequel on vivait.
Pas de sérénité, même une fois posé le choix de rester ?
Non, aucune. Le soir, quand on chantait complies, il y avait comme une chape de danger, de plomb, qui planait sur le monastère. De nuit, il pouvait arriver n'importe quoi. On se disait: que va-t-il se passer cette nuit? On n'envisageait pas d'être tués, mais on savait que cela pouvait arriver à n'importe quel moment. On avait la chance d'être une communauté. Et la vie continuait, l'un était cuisinier, l'autre jardinier, l'autre s'occupait de l'administration. Cela permettait d'oublier, mais le soir, la nuit, on se demandait ce qui pouvait arriver. On ne se le disait pas, mais chacun y pensait.
Et que s'est-il passé le soir de l'enlèvement ?
Le soir de l'enlèvement, j'étais dans la pièce du portier. Je me suis réveillé vers 1 heure, aux bruits de voix devant le portail. Ils étaient déjà à l'intérieur, dans le jardin. Sans doute voulaient-ils voir le docteur. J'attendais qu'ils frappent à la porte pour me manifester. Je suis allé voir à la fenêtre. J'en ai vu un qui allait directement vers la chambre de frère Luc. Ce qui n'était pas normal, car quand on veut voir le docteur, on frappe au portail et le portier se présente. Et j'ai entendu une voix qui disait: «Qui est le chef?». Et j'ai reconnu Christian. Je me suis dit: «Il les a entendus avant moi, il leur a ouvert et va leur donner ce qu'ils veulent.» Au bout d'un quart d'heure, j'ai entendu la porte qui donne sur la rue se fermer et j'ai pensé qu'ils étaient partis. Un peu plus tard, le père Amédée a frappé et m'a dit: «Les frères ont été enlevés!» Ils étaient donc sortis par derrière, sinon je les aurais entendus.
Qu'avez-vous ressenti alors ?
La question que je me suis immédiatement posée était de savoir: si je les avais entendus et vus sortir, qu'aurais-je fait? Serais-je resté ou aurais-je couru derrière pour aller avec eux?
Et votre réponse ?
Je n'ai pas encore répondu. Si cela s'était passé, cela n'aurait pas été facile, mais j'ai le sentiment que j'aurais couru derrière. Amédée m'a dit aussitôt: «Ils ne vont pas les tuer, car s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait tout de suite.» Il était en effet très difficile de circuler dans la montagne la nuit, car il y avait un poste militaire pas loin, sur la colline. De plus, frère Luc avait 82 ans et un autre venait de sortir de l'hôpital, avec six pontages. Marcher avec des gens comme cela, ce n'était pas facile. On pensait qu'ils allaient se servir d'eux pour quelque chose. En attendant, nous nous sentions tout seuls, privés de nos frères. La communauté était démolie. Nous espérions bien qu'ils seraient vite libérés, car s'ils ne revenaient pas, la vie était finie au monastère.
Pourquoi les ravisseurs ne sont-ils pas passés comme d'habitude ?
Quand ils venaient, ils faisaient le mur. Puis, de l'intérieur, ouvraient la porte qui donnait sur la rue. Il y avait une simple targette. Cette porte n'était jamais fermée à clé. Nous voulions que nos relations soient fondées sur la confiance mutuelle.
Les ravisseurs étaient des gens du GIA ou non ?
Le gardien du monastère m'a dit qu'ils étaient venus d'abord chez lui en disant qu'ils voulaient voir le docteur, sous prétexte qu'ils avaient deux blessés graves. Il leur avait répondu que les pères lui avaient interdit de prolonger son service de garde du monastère pendant la nuit. Ce qui était vrai, nous le lui avions interdit afin qu'il n'y ait pas de problème pour sa famille et pour lui en cas de malheur, s'il survenait une agression... Ils ont insisté. Le gardien est alors sorti de chez lui par la cour intérieure pour se rendre au monastère. Là, il est tombé sur un groupe qui était déjà dans la cour. Emmené devant le portail qui donnait chez le portier, il se trouvait au milieu d'un autre groupe qui avait déjà arrêté le père Christian. Ce dernier posa alors la question: «Qui est le chef?» L'un des ravisseurs répondit en désignant le meneur: «C'est lui, le chef, il faut lui obéir.» Puis l'un d'eux, s'adressant au gardien, demanda: «Ils sont bien sept?» Le gardien a répondu: «C'est comme tu dis.» Or, nous étions neuf... C'est donc probablement la raison pour laquelle père Amédée et moi-même n'avons pas été emmenés; car lorsqu'ils eurent arrêté sept frères, ils ont quitté les lieux sans fouiller la maison.
Mais vous, que pensez-vous: qui les a enlevés ? Le GIA ou l'armée ?
Nous ne savons que ce qui est arrivé au monastère. Pour le reste, on se pose des questions comme tout le monde. L'enquête continue. Pour ce qui est du GIA, le gardien m'a raconté que quand ils sont redescendus, l'un de ceux qui l'accompagnaient a dit à l'un de ses collègues: «Va chercher une ficelle, il va voir ce que c'est que le GIA», car ils voulaient l'égorger, mais il a réussi à s'éclipser.
Plusieurs années plus tard, vous n'y voyez pas plus clair sur les motifs de l'enlèvement ?
On n'y voit pas clair. Dans un de ses communiqués sur la radio Medi 1, le GIA donne une raison à leur mise à mort: «Les gens s'évangélisent à leur contact, car ils avaient des relations et ils sortaient de leur monastère, ce que des moines ne doivent pas faire. Ils méritent la mort. Nous sommes en droit de les exécuter.» Voilà donc une des raisons. Elle est donnée par les islamistes eux-mêmes. Par la suite, d'autres motifs ont été donnés qui sont plutôt des hypothèses, en attendant le verdict du juge d'instruction, qui poursuit une enquête sur les circonstances de leur enlèvement et de leur mise à mort.
Comment vivez-vous cette énigme ?
On aimerait bien savoir qui les a tués et où les corps sont enterrés. On aimerait bien le savoir, mais c'est tout, cela ne m'inquiète pas plus. Cela ne change rien à la mort des frères. Ils sont morts pour les raisons pour lesquelles ils avaient choisi de rester. C'est pour cela que ce sont des martyrs. Ils ont donné leur vie. Ils étaient prêts à donner leur vie pour cela.
Peut-on espérer le martyre ?
Certains l'ont fait, mais ce n'était pas notre état d'esprit. On ne le souhaitait pas, on n'était pas là pour cela. Mais il fallait être prêt à cela. Nous étions dans les mains de Dieu. Et c'est pour cela que, vivant dans cet état d'esprit, mes frères sont morts. Je dois reconnaître et dire que nous n'avons pas été extrêmement choqués. Bien sûr, cela marque, cela fait souffrir, cela fait de la peine... Mais on savait «pourquoi», on était tous prêts pour cela! La vie n'est qu'un passage, elle se termine d'une façon ou d'une autre. Après, on rejoint le Seigneur.
Le film de Xavier Beauvois, inspiré de leur sacrifice, peut-il être un ferment de réconciliation entre chrétiens et musulmans ?
Bien sûr! L'exemple des frères, dans leur relation avec les gens, avec les musulmans, montre que l'on peut devenir de vrais frères, dans la communion, ensemble, en profondeur et pas seulement en surface. En profondeur, devant Dieu. Certains l'ont vécu. Ce n'est pas rare. Quand les chrétiens voient cela, ils se rendent compte que les musulmans sont des gens comme les autres. Certains sont très bons: les valeurs d'accueil, de gentillesse, de serviabilité, se voient. Ainsi que les valeurs d'union à Dieu, de prières quotidiennes. Ils ont des relations avec Dieu qui sont parfois très surprenantes et qui sont de véritables exemples pour nous, chrétiens. Un ami de Christian, qui a donné sa vie pour lui, lui disait: les chrétiens ne savent pas prier... Ils sont très charitables, ils rendent beaucoup de services, mais on ne les voit jamais prier! Beaucoup de chrétiens pourraient entendre cela.
Vous n'avez jamais ressenti de haine pendant et après un tel drame ?
C'est curieux, mais je n'éprouve pas ce sentiment-là.
Et d'amertume ?
Non plus.
Comment interprétez-vous le durcissement actuel de certains musulmans contre les chrétiens, dont les attentats récents ont été un signe ?
Cela vient des extrémistes. Les vrais musulmans disent, ce n'est pas nous cela. Ils ont honte de ce qui est arrivé aux frères. Cela n'est pas la « religion ». D'autre part, on ne se connaît pas assez. On se perçoit à travers les violents et cela crée une tendance à se regrouper entre soi et une peur des contacts. La solution, c'est de cultiver l'amitié, même si on peut se faire rouler.
Se faire rouler ?
Oui, certains disent, la réciproque, on ne la voit pas ou peu: on permet aux musulmans de construire des mosquées chez nous, mais on peut toujours courir pour construire des églises chez eux!
Vous le pensez vraiment ? Les chrétiens sont, de fait, souvent accusés de naïveté avec l'islam...
La question n'est pas là. Par la foi, nous risquons! C'est dans l'Évangile: «Aimez comme je vous ai aimés.» Alors, on est souvent perdant, il faut le savoir. Mais il arrive que cela réagisse. Alors, la réciprocité est là et une reconnaissance mutuelle peut aller très loin.
Quelle est votre espérance pour 2011 ?
Il faut espérer que l'amour soit toujours le plus fort. Que l'amour de Dieu aura le dernier mot. Fondée en Dieu, l'espérance doit demeurer. Et ce n'est pas nous qui pouvons résoudre cela. L'espérance invin cible, comme disait Christian de Chergé. Elle ne doit pas être vaincue, elle doit toujours rester ouverte, fondée sur Dieu, sur Sa grâce. Même quand on meurt sous les coups. Comme il disait, l'espérance doit rester ouverte...